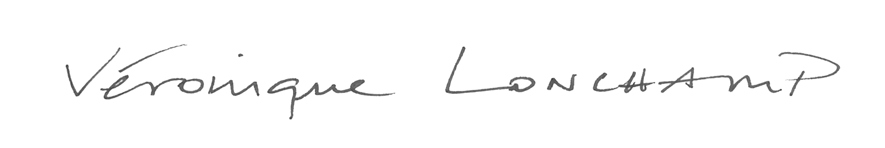Il est des œuvres qui, pour (sur)vivre, doivent être séparées du monde. Elles y étouffent, ne s’y épanouissent pas, y disparaissent. Elles nécessitent un univers particulier débarrassé des hommes – une boîte transparente, un globe, un espace obligatoire – qui puisse les extraire de leur environnement. Des roses sans épine.
Les sculptures de Véronique Lonchamp ont cette rare qualité d’être à leur place autant sur un socle et un fond vierge qu’au milieu de nous, car elles respirent l’humanité. Chacune constitue un monde clos, qui fonctionne isolément, et tout à la fois cherche à se lier à ce qui l’entoure – comme la plupart de ces objets présentés derrière des vitres dans les musées d’arts premiers, blessés par cette séparation d’avec leur milieu. Entourée de blanc, dans un écrin, une telle sculpture tient debout ; cachée à moitié par un bouquet de fleurs, sur une étagère pleine de livres, posée à côté de la poivrière et de l’huile d’olive, salie par les manipulations, elle est chose familière, à laquelle je peux me mettre à parler tout en faisant la cuisine. Double place, double fonction : œuvre sacralisée et objet du quotidien.
Cette façon de se faufiler dans la vie et d’y faire son nid ne m’étonne pas : le lien est à mon sens le cœur du travail de Véronique Lonchamp. Littéral quand il prend la forme d’une liane, d’un fil, d’un tapis qui se déroule, d’un escalier, d’un chemin de bois sur pilotis ; symbolique lorsqu’il s’agit d’un regard tourné ou d’une main tendue vers le ciel, le sol, l’autre. Souvent on monte ou on descend, on marche, on court, bref on relie un point à un autre. Souvent, on regarde, on contemple, on rêve, on médite : l’horizon est invisible, mais il est bien présent à travers la posture du petit personnage perché en haut de sa cahute branlante, et dont tout nous dit qu’il est appelé par le lointain, vers lequel à son tour il nous pousse. Ces sculptures interpellent leur environnement, elles s’y lovent, et créent ainsi un lien profondément intime avec lui.
Mais lien aussi avec le monde végétal, qui, de façon plus souterraine, est régulièrement convoqué : des bouts de bois flottant, des fruits de caroubier, des impressions de feuille sur l’argile – tout commençant avec cette noble matière qu’est précisément l’argile. Si les pièces sont de bronze, elles existent d’abord en terre crue. Le matériau a ici son importance, car l’argile nécessite le contact. Elle exige le travail direct des mains qui modèlent. Lien régulier avec le monde animal enfin : chats, chevaux et autres bêtes que l’artiste aime à représenter – tout ceci ayant commencé avec l’Arche qu’elle réalisa au moment de la naissance de son fils, prénommé Noé.
Des silhouettes souvent déséquilibrées, mais pas chancelantes
Des silhouettes paisibles, mais toujours conscientes
Des silhouettes giacomettesques, mais débarrassées de leur trop lourd désespoir
Des silhouettes flottantes, mais ancrées ici et maintenant
Des silhouettes songeuses, mais bienveillantes
Un peuple de personnages qui à la fois agit et pense, qui toujours noue le mouvement à la réflexion. Ceux qui observent sont sur le point de passer à l’acte. Ceux qui méditent sont déjà en train d’agir. Ceux qui se meuvent sont conscients de ce qu’ils font.
Bien sûr, des solitaires, il y en a. Ce n’est pas leur solitude qui les fait réfléchir, car les duos sont aussi souvent songeurs. Dans les binômes également, on se touche, on se rapproche – on se lie. Je suis seul, je suis deux, je suis dix. J’aime enfin les groupes agglomérés qui respirent la chaleur humaine. Se réunir, se blottir, s’allier pour parvenir à faire face au monde, puis à s’ouvrir à lui et à l’aimer. Penser et agir.
L’art de Véronique Lonchamp est un art nu, dépouillé. Il est d’une immense franchise. Il n’est pas aussi optimiste qu’il le paraît, mais néanmoins il guérit – et c’est en cela qu’il est art.
Juliette Solvès
28 février 2016